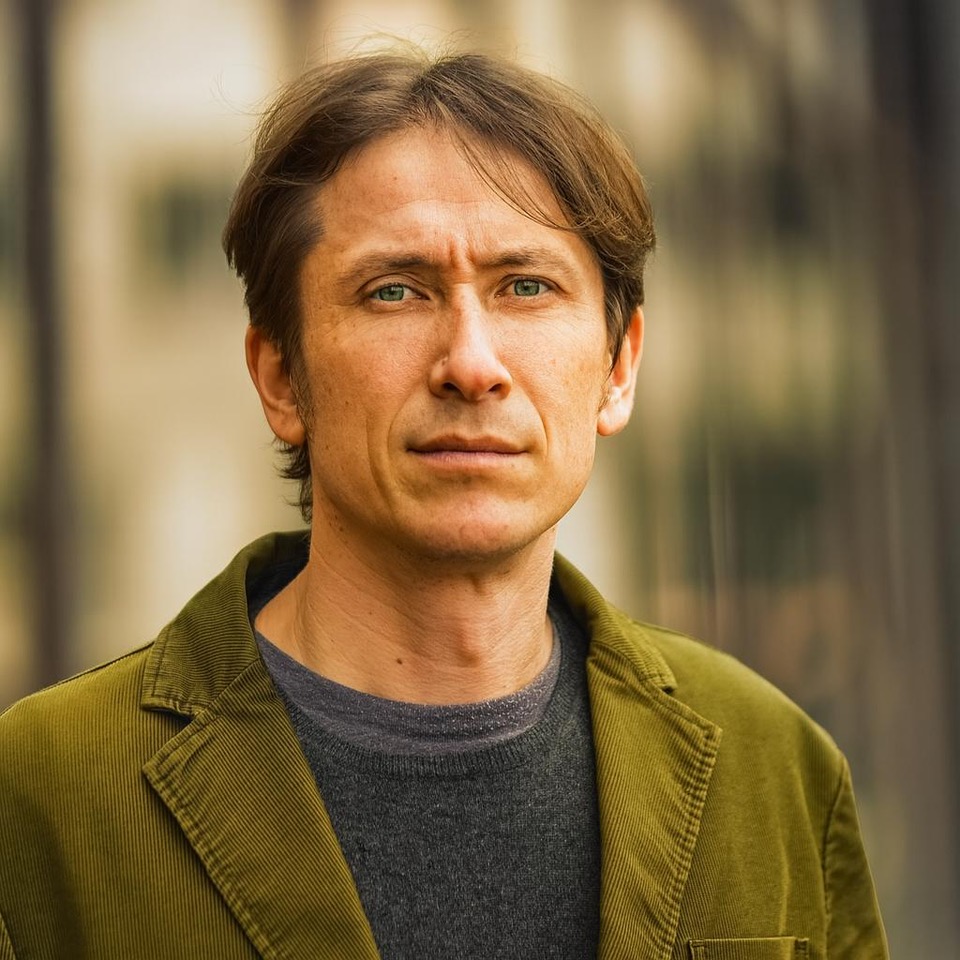Recherche révolutionnaire : imagerie de la croissance du réseau de champignons mycorhiziens en temps réel. Une étude de cinq ans.
Cette recherche vise à cartographier la croissance des réseaux fongiques mycorhiziens en temps réel. Comment le réseau se développe et comment les nutriments, y compris le flux de carbone à l'intérieur, sont régulés par le réseau lui-même.
lien vers l'article
La façon dont les champignons construisent ces réseaux semble mettre l'accent sur les gains à long terme par rapport aux avantages à court terme.
Les réseaux forment essentiellement toujours des systèmes de trafic bidirectionnels à l'intérieur de leurs tubes
La forme du réseau fongique est déterminée par quelques règles très simples et élégantes.
Résumé
Des scientifiques de l'AMOLF, de la Vrije Universiteit et de la SPUN ont construit un robot afin d'imager la croissance du réseau de champignons mycorhiziens en temps réel. Cela leur a permis de créer des cartes précises des réseaux et de suivre les flux de nutriments à l'intérieur. Après cinq ans de recherche, ils ont publié leurs premiers résultats dans NATURE. L'article traite de la façon dont ces champignons construisent et exploitent leurs chaînes d'approvisionnement pour l'échange et le commerce souterrains de nutriments.
Cette recherche vise à cartographier la croissance des réseaux fongiques mycorhiziens en temps réel. Comment le réseau se développe et comment les nutriments, y compris le flux de carbone à l'intérieur, sont régulés par le réseau lui-même.
Cartographie de la croissance du réseau fongique mycorhizien en temps réel
Pouvoir relier les flux à l'architecture est totalement nouveau. L'enregistrement et l'imagerie de la forme de la carte complète du réseau n'ont également jamais été réalisés auparavant.
Le programme de recherche que nous développons sur les champignons mycorhiziens vise à comprendre comment ces microbes très inhabituels se déplacent et échangent des nutriments avec les plantes sous terre. Ils sont présents dans les sols du monde entier dans tous les environnements terrestres. Il est donc important de comprendre comment ils fonctionnent comme un tissu conjonctif pour les écosystèmes. Il existe des preuves irréfutables que ces champignons peuvent modifier la façon dont ils se déplacent/échangent les nutriments en fonction de leurs partenaires végétaux et de l'environnement des ressources. Mais nous en savons très peu sur comment c'est ce qu'ils font. Nous voulons comprendre comment ils parviennent à contrôler leur comportement, même s'ils n'ont pas de cerveau, etc.
Comparés à quelque chose comme une cellule bactérienne, ces champignons sont très complexes. Et ce qui les rend particulièrement complexes, c'est la topologie de ces réseaux. En fait, nous sommes en train de cartographier un réseau urbain. Nous considérons le réseau fongique comme un réseau routier, ce qui nous permet de poser des questions sur la distribution et le transport.
Finalement, nous nous sommes rendu compte que les gens n'ont tout simplement pas fait la chose la plus simple, qui est simplement de les laisser grandir et de regarder ce qu'ils font. Et lorsque nous avons réalisé que c'était ce que nous voulions faire, un défi majeur s'est présenté : les cultiver en laboratoire.
Personne n'a vraiment réussi à voir comment ces champignons construisent leurs réseaux à cette échelle. Les gens ont pris des photos des réseaux à différents moments, mais personne n'a réussi à faire de film. Cela a été l'un de ces moments vraiment délicieux pour la science. Parfois, lorsque vous plongez dans quelque chose de complètement nouveau, il est en fait plus productif de ne pas avoir d'hypothèse.
Cartographie de la croissance fongique avec un robot
Ce que fait réellement le robot, c'est parcourir les réseaux mycorhiziens qui se développent dans les boîtes de Pétri. Le robot que nous utilisons dans l'article Nature peut y parvenir avec quarante boîtes de Pétri différentes. Quarante réseaux différents en même temps. Et il fonctionne maintenant vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Le robot nous a permis d'étiqueter et de surveiller un demi-million de nouveaux nœuds et de cartographier l'extension du réseau en temps réel.
Dans le « monde réel », des réseaux de champignons mycorhiziens vivent dans le sol, qui constitue un environnement particulièrement difficile à observer. Cela explique pourquoi il n'a tout simplement pas été fait beaucoup de choses pour faire de l'imagerie de manière systématique. Nous avions donc vraiment besoin de construire ce robot pour voir ce réseau grandir. Cela nous permettrait d'imager, de cartographier et de créer des modèles pour étudier le réseau.
L'imagerie robotique des réseaux fongiques nous fournit des informations sur le trafic
Le robot que nous avons construit survole les boîtes de Pétri et prend de nombreuses images agrandies. Pour construire des cartes à partir de ces images, nous avons créé un pipeline d'analyse de données. Il assemble toutes ces images et extrait la topologie et la morphologie du réseau fongique, qui constituent la carte. Mais ce n'est que la structure. Si vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne ce réseau, comment il déplace les nutriments sous terre, vous devez être capable de zoomer plus en détail. En gros, nous devions examiner l'intérieur de chaque tube du réseau et étudier ce que nous appelons les « informations sur le trafic ».
La possibilité d'obtenir une image détaillée de ce qui se passe à l'intérieur de ces réseaux, ainsi que la carte complète du réseau, constitue la véritable nouveauté. Cela n'a été possible que parce que nous avons construit ce robot d'imagerie. Sans lui, nous ne serions tout simplement pas en mesure de collecter les données nécessaires assez rapidement. Vous pouvez considérer ce que fait le robot comme une imagerie satellite : il prend des clichés à grossissement relativement faible lorsqu'il se déplace sur un terrain fongique. Pour voir les flux à l'intérieur, nous zoomons en passant à un grossissement plus élevé à des points d'intérêt spécifiques de la carte du réseau. Cette partie ressemble davantage à des hélicoptères qui survolent les villes pour recueillir des informations sur le trafic. De cette façon, le robot nous permet d'étudier réellement comment les modèles de trafic dynamiques sont liés à la structure du réseau dans son ensemble.
L'une des choses qui m'a vraiment donné envie de travailler sur les champignons mycorhiziens, c'est que lorsque vous zoomez et que vous regardez à l'intérieur de ces tuyaux, vous voyez du liquide s'écouler dans les deux sens, en même temps ! Et c'est tout simplement contre-intuitif. Certainement pour un physicien, mais je pense vraiment pour n'importe qui (quand avez-vous vu pour la dernière fois une rivière couler dans deux directions à la fois ?) D'après ce que nous savons des écoulements de fluide dans des récipients étroits, les lois habituelles indiquent simplement que la direction du mouvement du fluide est déterminée uniquement par la différence de pression à travers le tuyau. Les choses ne circulent donc pas dans les deux sens en même temps, et c'est pourquoi nous avons été très surpris de voir cela chez ces champignons. J'ai tout de suite été captivée, car on pouvait voir à l'œil nu que ces organismes avaient inventé quelque chose de remarquable, une étrange forme de physique, afin de rendre cela possible. Parfois, lorsque vous voyez quelque chose, vous savez immédiatement que c'est spécial. Il s'agissait certainement de l'un de ces cas.
Cartographie des flux de carbone bidirectionnels
Et il est logique que le fluide circule dans les deux sens. Pensez simplement à ce que ces organismes doivent faire. Ils tirent tout leur carbone des plantes. Mais ils ne l'obtiennent pas gratuitement, ils doivent « payer » pour cela avec d'autres ressources nutritives (principalement du phosphore et de l'azote) qu'ils recherchent en développant leurs réseaux vers l'extérieur à partir de la racine et jusque dans le sol. Pour alimenter cette croissance, ils doivent constamment éloigner le carbone de la racine. Dans le même temps, ils doivent également récupérer les éléments nutritifs du sol qu'ils ont récoltés pour acheter plus de carbone. D'où le trafic à double sens. Les choses doivent évoluer dans les deux sens tout le temps.
Une autre chose vraiment fascinante que nous avons remarquée est que les flux à travers le réseau sont extrêmement dynamiques. C'est une chose que le fluide circule dans les deux sens en même temps dans le même tuyau. Ce que nous avons également remarqué assez rapidement, c'est que si vous observez différentes parties du réseau à des moments différents, les comportements des flux sont très divers et changent également au fil du temps. Non seulement ils circulent dans les deux sens en même temps, mais ils peuvent aussi changer soudainement de direction et commencer à s'écouler dans l'autre sens.

Champignons mycorhiziens et chaînes d'approvisionnement des réseaux
Un défi comparable lors de la construction du robot a été d'automatiser le traitement des données, que le robot produit constamment en masse. Nous avions besoin de développer un pipeline informatique qui extrait l'architecture du réseau sans intervention humaine. Cela a permis à notre équipe d'étudier les cartes obtenues afin de décider sur quels emplacements de réseau spécifiques zoomer.
En termes commerciaux, le réseau de croissance des champignons mycorhiziens en dehors de la racine de la plante ressemble à une chaîne d'approvisionnement. La question que nous posons dans cet article est la suivante : comment le champignon construit-il cette chaîne d'approvisionnement ? Et une fois construit, comment le fait-il fonctionner ? Le robot nous a permis d'imager l'ensemble du réseau de la chaîne d'approvisionnement. C'est une chose de ne voir qu'une partie d'un réseau, mais lorsque vous avez la carte de l'ensemble, vous pouvez commencer à vous poser différents types de questions.
À l'échelle de l'ensemble du réseau, on sait que ces champignons modifient leur comportement en matière d'échanges de nutriments en fonction des partenaires végétaux spécifiques et des conditions environnementales. Donc, dans un sens réel, on pourrait dire que le réseau prend la décision de faire X ou Y. Mais si vous pensez à la façon dont les organismes prennent des décisions, généralement, ceux auxquels nous avons tendance à penser sont ceux qui ont un cerveau. Ces organismes prennent des décisions à l'aide du système nerveux. Le champignon n'en a pas à sa disposition. Nous en savons très peu sur les mécanismes de traitement de l'information et de prise de décision chez un champignon.
Le document de recherche a été produit par une équipe multidisciplinaire composée de quatre institutions et de vingt-huit auteurs. Les principales catégories de personnes étaient les physiciens, les biologistes, les ingénieurs et les informaticiens. Les deux héros qui ont dirigé l'article sont les premiers auteurs Loreto Oyarte Galvez, qui a construit le robot avec une excellente équipe d'ingénieurs AMOLF, et Corentin Bisot, qui a développé le pipeline de calcul ainsi qu'une grande partie de la théorie et de la modélisation. Le projet a débuté comme une collaboration entre mon propre groupe à l'AMOLF, le groupe de Toby Kier à la Vrije Universiteit et le groupe de Howard Stone à Princeton. Je suis un physicien qui travaille sur le vivant, un biophysicien. Toby est biologiste évolutionniste et écologiste, et Howard Stone est expert en mécanique des fluides. L'équipe a également bénéficié de la participation de l'informaticien Christophe Godin de l'ENS Lyon en France, expert en morphogenèse végétale.

Principaux résultats de la recherche
1. La première chose que nous avons apprise est que la façon dont les champignons construisent ces réseaux semble privilégier les gains à long terme par rapport aux avantages à court terme. Ce n'est pas ce que la plupart des microbes ont tendance à faire. Lorsqu'ils trouvent un bon endroit, ils se développent autant que possible jusqu'à ce qu'ils soient à court de ressources. En revanche, ces champignons, après s'être attachés à la racine d'une plante, se répandent comme une vague à très faible densité. Ils semblent accorder la priorité à l'exploration d'autres plantes. Peut-être ceux qui pourraient leur offrir un meilleur accord commercial. Ils semblent rechercher de nouvelles opportunités d'extraction et de commerce des ressources, plutôt qu'une croissance immédiate. Les champignons résolvent donc un problème de recherche de nourriture, mais un problème particulier. C'est comme s'ils recherchaient des opportunités commerciales, plutôt que de la nourriture en soi.
2. La deuxième constatation est que les réseaux forment essentiellement toujours des systèmes de trafic bidirectionnels à l'intérieur de leurs tubes. J'ai mentionné que c'est quelque chose que nous avons vu lorsque nous avons commencé à étudier les images. Chaque filament du réseau est un tube. Et dans presque tous les tubes où nous avons observé un mouvement, il y avait des écoulements dans les deux sens. C'est très intéressant, et c'est plutôt logique. Si vous pensez au trafic routier humain, les routes à double sens permettent un routage plus efficace que les systèmes à sens unique. Mais ils sont également plus sensibles à la congestion. Mais pour le trafic fongique, les flux sont constitués de fluides et non de voitures. Les fluides ne souffrent pas vraiment de congestion comme le fait la circulation automobile. Les flux de fluides bidirectionnels constituent donc une solution vraiment ingénieuse pour un trafic de nutriments efficace à travers ces réseaux.
3. La troisième découverte est que la forme du réseau fongique est déterminée par quelques règles très simples et élégantes. Lorsque vous examinez suffisamment de ces réseaux, vous commencez à vous demander comment les champignons parviennent-ils à contrôler la forme de leurs réseaux. Il s'avère que les règles qu'ils suivent ne nécessitent que des informations locales. Pour prendre une décision quant à la manière de construire ici, vous avez juste besoin d'informations sur ce qui se passe à proximité, et non sur ce qui se passe sur l'ensemble du réseau. En d'autres termes, le processus n'a pas vraiment besoin d'un système de contrôle centralisé ou d'un cerveau pour contrôler la forme du réseau. Un bon exemple est que si une pointe de croissance heurte une autre pointe de croissance, une autre extrémité du réseau, les deux fusionnent.
Conclusion
Nous ne nous attendions pas à trouver cette autorégulation extrême de la croissance en faveur de l'exploration et du commerce. Et quand nous l'avons trouvée, nous ne nous attendions pas à pouvoir identifier les règles de ramification et de fusion qui expliquent cette autorégulation. Il n'était pas non plus évident dès le départ que nous serions réellement en mesure de cartographier l'ensemble du réseau à tout moment au fur et à mesure de sa croissance. C'était donc un moment vraiment excitant, lorsque nous avons réalisé que cela allait réellement fonctionner. Ces données nous font réaliser à quel point ces réseaux sont différents des colonies microbiennes typiques, qui tentent généralement de remplir l'espace disponible par la croissance. Les champignons MA semblent ne se développer que dans la mesure où ils en ont besoin pour relier leurs partenaires commerciaux et les sites d'extraction des ressources. Comprendre mathématiquement ces structures est un défi. Nous sommes ravis d'avoir pu développer un modèle mathématique très simple qui décrit le processus par lequel ces réseaux sont générés dynamiquement, à la suite de modèles de croissance ondulatoires. De manière très concrète, la dynamique de ces ondes décrit également la façon dont le carbone d'origine végétale se déplace dans les environnements du sol.